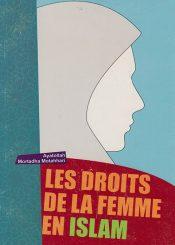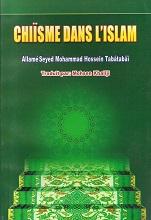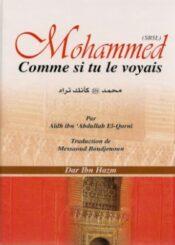L’ASTRONOMIE ARABE

L’ASTRONOMIE ARABE
Author :
Editor :
Publish number :
Première édition
Publication year :
2008
Number of volumes :
1
(0 Votes)

(0 Votes)
L’ASTRONOMIE ARABE
Le moyen âge est une période de notre histoire occidentale qui ne laisse pas grand trace de découvertes scientifiques. L’obscurantisme aidé par les débuts d’un christianisme totalitaire et extrémiste a fait taire toutes les tentatives de progrès.C’est au contraire la religion islamique qui a poussé les arabes à une meilleure connaissance de l’astronomie. L’histoire de l’astronomie arabe renvoie aux travaux effectués par la civilisation islamique entre le 9ème et le 16ème siècle, travaux transcrits en langue arabe. Les arabes ne sont pas partis de zéro dans ce domaine, mais se sont inspirés, du moins au début, des grands philosophes grecs, et en particulier du dernier d’entre eux, Claude Ptolémée et de son ouvrage qui compilait, avec ses propres solutions aux problèmes en suspens, les connaissances occidentales en ce deuxième siècle après Jésus Christ : l’Almageste. Le nom original de cette oeuvre de Ptolémée est « La composition mathématique ». Les arabes, très impressionnés par cet ouvrage, le qualifièrent de « megiste », du grec signifiant « magistral, très grand », bauquel ils ajoutèrent l’article définit arabe al, pour donner al megiste qui devint almageste. Au début de cette histoire, l’astronomie stagnait donc depuis 7 siècles. Rien ne s’est passé en occident entre Ptolémée et le 9ème siècle, mis à part une légère différence sur l’origine du monde. Les anciens grecs considéraient en effet que l’univers n’avait pas de commencement, contrairement aux trois religions monothéistes, dont l’islam, qui proposent une genèse de l’univers. L’état des connaissances astronomiques de cette époque reposait sur les principes suivants : · La Terre est immobile au centre du monde (et elle est ronde). · Tous les autres corps tournent autour de la Terre. · Le cercle étant la seule forme parfaite, ces autres corps tournent selon des trajectoires circulaires. Mais certaines planètes ne suivent pas ces règles parfaites. Il fallait rendre compte par exemple de la rétrogradation apparente de Mars en introduisant d’autres figures parfaites secondaires, encore des cercles. Plus la précision des mesures s’améliorait, plus il fallait utiliser ces « épicycles » imbriqués. C’est vite devenu très compliqué et inextricable.